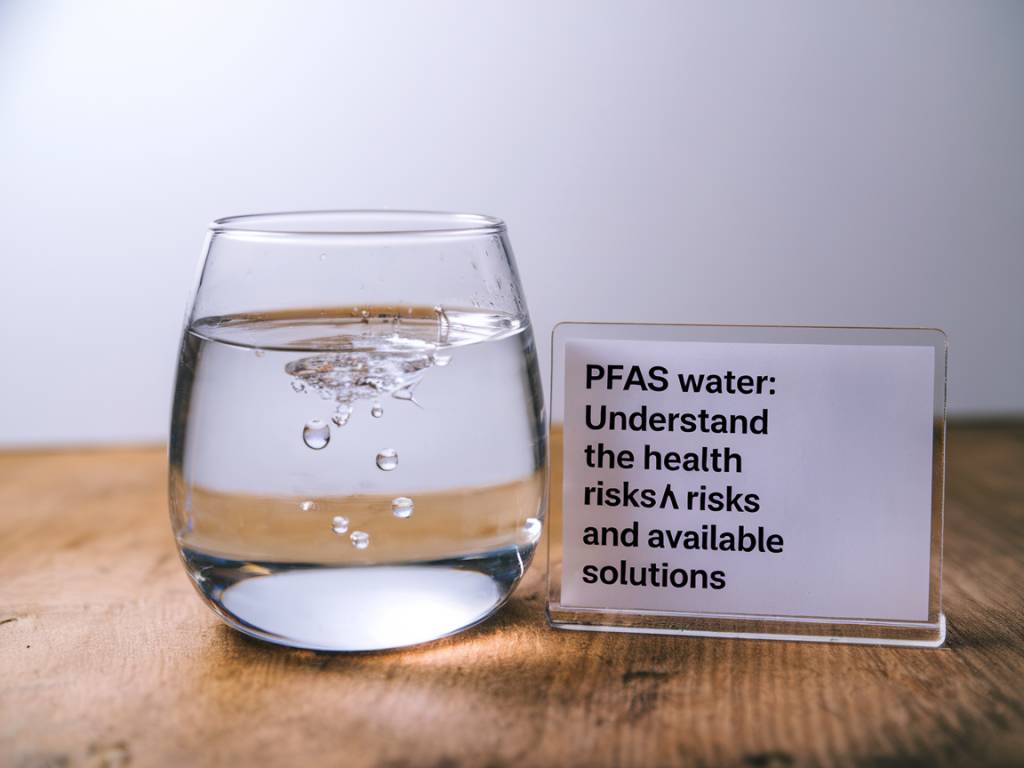Le radon : un ennemi invisible dans les foyers suisses
Imaginez un gaz inodore, incolore, insipide – et pourtant potentiellement mortel. Non, ce n’est pas le début d’un roman de science-fiction. C’est la réalité quotidienne de nombreuses habitations suisses, sans que leurs occupants ne s’en doutent. Ce gaz s’appelle le radon, et il est bien réel. En Suisse, il représente la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Pourtant, il reste largement méconnu du grand public.
Alors, à quoi devons-nous faire face exactement ? Quels sont les réels dangers ? Qui est concerné ? Et surtout : comment s’en protéger efficacement ? Tour d’horizon d’un problème trop souvent relégué au second plan, mais qui mérite toute notre attention.
Qu’est-ce que le radon, et d’où vient-il ?
Le radon est un gaz radioactif naturel. Il se forme par la désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre, plus précisément dans les roches et les sols. Invisible et inodore, il s’infiltre facilement dans les bâtiments, notamment par les fissures dans les fondations, les conduits non étanches ou les canalisations mal isolées.
En extérieur, il est rapidement dilué dans l’air ambiant et ne pose généralement pas de problème. Mais à l’intérieur, les concentrations peuvent grimper dangereusement, surtout dans les pièces en contact direct avec le sol comme les caves, les garages ou les rez-de-chaussée.
Et devinez quoi ? La Suisse n’est pas vernie. Notre pays, en raison de sa géologie variée – notamment les formations granitiques dans certaines régions – est particulièrement touché par ce phénomène.
Une menace silencieuse pour la santé
Pourquoi s’inquiéter ? Parce que le radon n’est pas qu’un gaz inoffensif. Inhalé en trop grande quantité sur une longue période, il libère des produits de désintégration radioactifs qui peuvent détériorer les cellules pulmonaires. Le résultat : une augmentation significative du risque de développer un cancer du poumon.
Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), environ 200 à 300 décès par cancer du poumon sont attribués chaque année à une exposition au radon en Suisse. Pour mettre cela en perspective : une personne vivant toute sa vie dans une maison où la concentration de radon dépasse les 1000 Bq/m³ voit son risque de développer un cancer du poumon multiplié par trois.
Et non, contrairement à une idée reçue, ce n’est pas une menace limitée aux fumeurs. Certes, les fumeurs restent particulièrement vulnérables, le risque étant synergique, mais les non-fumeurs ne sont pas pour autant hors de danger.
Quelles régions suisses sont les plus à risque ?
L’ensemble du territoire n’est pas concerné de la même manière. L’OFSP a établi une carte des zones à potentiel élevé de radon. Parmi les plus touchées :
- Le Valais, avec ses formations cristallines et ses sols poreux
- Les Grisons, notamment dans les vallées encaissées
- Le Jura, en raison de ses strates calcaires et de ses failles géologiques
- Certaines parties de la Suisse centrale et orientale
Cela ne signifie pas pour autant que les autres régions sont à l’abri. Même dans les zones à faible risque géologique, des concentrations dangereuses peuvent être relevées en fonction de la structure du bâtiment ou de son entretien.
Comment savoir si votre maison est concernée ?
Le seul moyen fiable de savoir si votre maison est exposée est de mesurer la concentration de radon. Là encore, surprise : le test est simple, peu coûteux et facile à réaliser.
Il suffit généralement de se procurer un dosimètre à radon auprès d’un laboratoire agréé (la liste est disponible sur le site de l’OFSP), de le placer dans la pièce la plus utilisée – souvent le salon ou une chambre – pendant environ trois mois, puis de le renvoyer pour analyse. Le coût ? Environ 50 à 100 CHF, analyse comprise.
À l’issue du test, vous recevez un rapport clair indiquant la concentration moyenne de radon mesurée (en becquerels par mètre cube – Bq/m³) et des recommandations en cas de dépassement.
Quels sont les seuils critiques ?
L’Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser une concentration de 100 Bq/m³. En Suisse, la valeur de référence est fixée par la législation à 300 Bq/m³. Lorsqu’elle est dépassée, des mesures de remédiation doivent être envisagées, surtout si les habitants passent beaucoup de temps dans la pièce concernée.
Mais soyons clairs : même des concentrations inférieures à cette limite ne sont pas sans risque, surtout sur le long terme. D’où l’intérêt d’agir préventivement.
Que faire si les concentrations sont trop élevées ?
Pas de panique. Il existe aujourd’hui plusieurs moyens efficaces pour réduire la concentration de radon dans un bâtiment, selon la cause de l’infiltration :
- Ventilation : L’augmentation de la ventilation, notamment par l’installation de systèmes mécaniques contrôlés (VMC), permet souvent de réduire considérablement la concentration intérieure.
- Étanchéité : Réparer les fissures dans les sols ou les murs, calfeutrer les passages de canalisations, poser des membranes étanches peut éviter l’infiltration du radon.
- Dépressurisation du sol : Technique plus avancée, consistant à créer une zone de basse pression sous la dalle pour empêcher le radon de remonter dans la maison.
Un conseil ? Faites impérativement appel à un spécialiste certifié en géotechnique ou en protection contre le radon. L’OFSP tient à jour une liste de professionnels qualifiés.
Un enjeu pour les constructions neuves également
Étonnamment, nombre de maisons récentes sont également concernées. Et pour cause : la chasse à l’énergie grise et à la déperdition thermique pousse à construire des logements de plus en plus hermétiques. Résultat : les éventuelles concentrations de radon peuvent s’accumuler davantage qu’avant, en l’absence de ventilation adéquate.
Bonne nouvelle néanmoins : depuis le 1er janvier 2018, les nouvelles constructions situées dans des zones à risque identifié doivent intégrer des mesures de prévention contre le radon dès la phase de conception (selon l’Ordonnance sur la radioprotection ORaP).
Radon et écoles : une vigilance accrue nécessaire
Les enfants étant plus sensibles aux radiations, les écoles et crèches sont des lieux particulièrement à surveiller. Certaines communes suisses ont déjà entrepris des campagnes de mesure dans les établissements publics. Et les résultats ne sont pas toujours rassurants. À Fribourg ou en Valais, par exemple, plusieurs cas de concentrations dépassant les seuils légaux ont été recensés ces dernières années, forçant les autorités à engager des travaux d’assainissement en urgence.
Une démarche salutaire qui devrait être généralisée à l’ensemble du pays.
Vers une meilleure sensibilisation des citoyens
Le radon ne fait pas souvent la une des journaux. Il n’a pas l’aura dramatique des catastrophes nucléaires ni l’image choc du CO₂. Pourtant, son impact sanitaire est bien réel. Depuis quelques années, les autorités suisses redoublent d’efforts pour sensibiliser le public :
- Campagnes d’information régionales
- Subventions pour les diagnostics et les travaux d’assainissement
- Mise à disposition de cartes interactives sur le risque radon
Mais il reste encore du chemin à faire. Peu de propriétaires connaissent leur exposition réelle, et encore moins passent à l’action – souvent faute d’information claire ou par souci de budget.
Alors, que faire en tant que citoyen ?
Simple : mesurer, s’informer, et si besoin, agir. Tout comme on installe un détecteur de fumée pour anticiper un incendie, faire tester son logement au radon est un acte de prévention rationnel et responsable.
Vous êtes locataire ? Discutez-en avec votre régie ou votre propriétaire. Certains cantons encouragent même les démarches collectives pour les immeubles ou les quartiers entiers.
Et si vous êtes en train de faire construire votre maison ? Parlez radon avec votre architecte. Intégrer dès le départ des matériaux adaptés, une ventilation contrôlée ou une étanchéité renforcée peut non seulement vous faire économiser des frais futurs, mais aussi préserver votre santé et celle de votre famille.
Car après tout, respirer un air sain, ça devrait être la base, non ? Même (et surtout) quand on est chez soi.